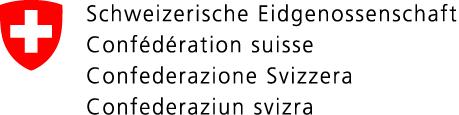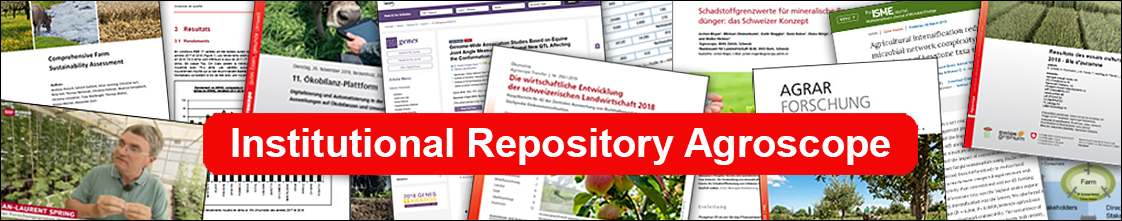Les systèmes de traite automatisée (STA) sont autorisés dans certaines filières fromagères AOP, mais interdits par d'autres qui craignent une altération de l’image artisanale et de la qualité du lait. Leur adoption peut également influencer la gestion des exploitations, notamment en ce qui concerne la pâture des vaches. Cette étude vise à évaluer l’impact des STA sur la qualité du lait, son lien au terroir, la biodiversité bactérienne, l’aspect social et l’image afin d’aider l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) à prendre des décisions éclairées. Les résultats permettront de renforcer la base législative pour l’enregistrement des fromages et produits laitiers en AOP. Les études antérieures ainsi que la littérature scientifique indiquent que le lait issu de la traite avec des STA présente systématiquement un taux plus élevé d’acides gras libres par rapport à celui issu des salles de traite conventionnelles (traite 2x/jour). Cette lipolyse peut avoir différentes origines: microbienne, induite ou spontanée. La première partie de cette étude a examiné les données disponibles sur les taux d’acides gras libres mesurés entre 2017 et 2024 lors du contrôle officiel du lait chez 73 producteurs de lait de non-ensilage de la filière Emmentaler AOP. Tous utilisent actuellement un STA, mais 50 d’entre eux l’ont installé au cours de la période examinée. Les résultats montrent que chez 22 producteurs, le taux d’acides gras libres a significativement augmenté, tandis que dans 9 exploitations, il a significativement diminué. Pour la seconde partie de l’étude, 46 producteurs de lait avec un STA ont été sélectionnés puis visités un à un afin de collecter les données des exploitations. Le questionnaire comprenait différents paramètres relatifs à l'élevage et à la gestion de l'exploitation, ainsi qu'à l'installation, aux composants utilisés, aux réglages et aux données de traite du STA. La collecte de données s'est concentrée sur les facteurs susceptibles d'influencer la qualité du lait. L'hygiène de l'étable et des animaux a également été prise en compte. En ce qui concerne la détention, il a été confirmé que le STA et le pâturage peuvent être combinés lorsque les conditions de l'exploitation sont réunies (pâturages regroupés). 89 % des exploitations visitées pratiquaient le pâturage en blocs ou avec un portail de pâturage. Dans la troisième partie, trois échantillons de lait ont été prélevés en hiver 2024 auprès de ces 46 producteurs avec un STA et de 46 autres producteurs de lait équipés de salles de traite, appartenant aux mêmes fromageries. Les teneurs en acides caproïque et butyrique ont été déterminées. Les valeurs de ces dernières analyses ainsi que celles obtenues par le contrôle du lait ont ainsi été utilisées afin de classer les 46 STA en trois groupes en fonction du degré de lipolyse: basse, moyenne et élevée. Les données de chaque paramètre ont été comparées dans les trois groupes. Même si tous les paramètres de l’exploitation et de l’installation sont déterminant pour un maintien de la bonne qualité du lait, seul le nombre de vaches laitières (moyennes des 3 groupes: lipolyse basse 48 ; lipolyse moyenne 42 ; lipolyse élevée 39) et la quantité de lait par vache par traite (moyennes des 3 groupes: lipolyse basse 10,7 kg ; lipolyse moyenne 9,5 kg ; lipolyse élevée 9,7 kg) démontre une différence légèrement significative. Aucune différence significative n'a pu être constatée pour tous les autres paramètres relevés concernant le STA et les données de traite. En comparant les systèmes de traite, le centile 25 % des acides butyriques 24h présentent des différences hautement significatives (test de T, valeur P <0.0001). Les STA présentent une moyenne de 76 mmol/kg alors que les salles de traite se situent vers 57 mmol/kg. Cependant, l'étude n'a pas permis de déterminer quels facteurs jouent un rôle déterminant dans l’augmentation des acides gras libres. En parallèle, la biodiversité bactérienne des laits provenant des 46 STA et 46 salles de traite a été déterminée par séquençage des gènes codant pour l’ARNr 16S. L’indice de diversité de Shannon ainsi que la quantité bactérienne n’ont montré aucune différence significative entre les deux groupes. En analysant les abondances relatives des espèces bactériennes, on remarque que la teneur en agents pathogènes responsables de mammites avait tendance à être plus élevée dans les exploitations avec salle de traite. La fréquence de détection des agents pathogènes responsables des mammites avait tendance à être plus élevée dans les exploitations équipées de salle de traite. La désinfection intermédiaire des outils de préparation et des manchons trayeurs s'est avérée bénéfique. Au niveau de la biodiversité microbienne des souches typiques de la pâte et de la croûte du fromage, il y a peu de différence entre les STA et les salles de traites. En revanche, certains agents de désinfection, comme l’acide lactique utilisé pour la désinfection des trayons post-traite, semblent mieux contribuer à la préservation des bactéries utiles à la fabrication du fromage. L’étude n’a pas porté sur la compatibilité des STA utilisés en continu avec les exigences des cahiers des charges de certaines dénominations enregistrées en tant qu’AOP comme la limitation du nombre de traites à deux par jour; la livraison du lait directement après la traite; le stockage du lait dans des cuves en cuivre et/ou à des températures supérieures à 8 °C. Ces critères étant définis individuellement par chaque filière afin de garantir la typicité des produits. Les systèmes de traite automatisée (STA) sont de plus en plus utilisés dans l'élevage laitier suisse, mais les facteurs de décision pour leur adoption ont été peu étudiés. Cette étude a examiné les facteurs d'influence sociaux et psychologiques sur l'adoption des STA, en particulier dans le contexte de la production de lait de fromagerie AOP, au moyen d'une enquête quantitative et d'entretiens qualitatifs. Les résultats montrent que l'éducation supérieure, les compétences numériques et la taille de l'exploitation jouent un rôle, tandis que le revenu n'a pas d'influence significative. Les interviews mettent en évidence que la décision d'opter ou non pour le STA s'explique en premier lieu par des raisons économiques et d'organisation de l'exploitation et dépend moins des réglementations AOP. Dans l'ensemble, on constate une tension entre tradition et innovation, les deux modes de production pouvant atteindre la qualité de lait requise. Plusieurs études ont déjà examiné les facteurs qui influencent l'utilisation des technologies dans l'agriculture. En revanche, la perception des consommateurs a été moins bien étudiée jusqu'à présent. Une première étude menée en Suisse alémanique auprès de 287 personnes a montré que les consommateurs évaluent les technologies agricoles de manière fondamentalement positive (valeur moyenne de 70,4 sur une échelle de 0 = très négatif à 100 = très positif). Les systèmes de traite automatisée (STA) ont également été perçus de manière généralement positive en termes d'associations spontanées, mais des préoccupations ont également été exprimées concernant le bien-être des animaux et la relation entre l'homme et l'animal. Une seconde enquête, plus importante, menée auprès de 485 personnes, tant en Suisse alémanique qu'en Suisse romande, a confirmé cette perception positive avec de légères différences régionales. En Suisse romande, par exemple, les valeurs moyennes mesurées pour la disposition à consommer des produits fabriqués à l’aide de STA étaient légèrement plus élevées (80,3) qu'en Suisse alémanique (77,9). Les résultats montrent qu'une communication ciblée est nécessaire pour mieux informer les consommateurs et renforcer leur confiance dans les nouvelles technologies agricoles.